- AVANT-PROPOS
- A la UNE
- PRESENTATION
- ACTUALITE SCIENTIFIQUE et TECHNOLOGIQUE
- ACTUALITE ARTISTIQUE
- BLOG
- CONSCIENCE
- PLANETE VIVANTE
- SCIENCES
- Sciences et histoire
- Science et politique
- Science/conscience
- Médecine de demain
- Le COVID-19
- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 1 -
- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 2 -
- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 3 -
- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 4 -
- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 5 -
- COVID-19 - Journal d'une pandémie -6 -
- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 7
- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 8
- COVID -19 - Journal d'une pandémie - 9
- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 10
- COVID-19 - Journal d'une pandemie - 11
- Arts et sciences
- L'homme debout
- Les débuts de la sagesse
- L'épopée scientifique
- Chimie, vivant... une si longue histoire !
- Introduction : 52 choses que je sais d'elle
- Sommaire
- 1 - Premiers pas
- I - A l'origine
- II - De la tetrasomia et l'alchimie à la chimie moderne
- III - al-kimiya
- IV - Alchimie : de l'aube à la fin de la Renaissance
- V - De l'(al)chimie à la chimie : une question de méthode ?
- VI - L'alchimie selon Newton, première partie
- VII - L'alchimie selon Newton, deuxième partie
- 2 - La chimie des Lumières
- XI - Chimie au siècle des Lumières - Introduction
- XII - Chimie au siècle des Lumières- Les affinités électives
- XIII - Diderot et la chimie
- XIV - Diderot - La chimie, pourquoi ?
- XV- Diderot chimiste
- XVI- La chimie et le Rêve de D'Alembert
- 3 - La chimie du vivant
- X - Chimie et Vivant - Introduction
- XIX - La génération spontanée
- XX - Fermentation : duel à 3 !
- XXI - Stéréochimie : clé du Vivant
- XXII - Homochiralité et origine de la vie
- XXIIc - Origine de la vie : état des lieux... provisoire
- XXIIb - Des biopolymères aux premiers organismes vivants
- XXIII- Stéréochimie et activité biologique
- XXIV - Chimie du cerveau - 1- Un cerveau, trois cerveaux, des cerveaux...
- XXV - Chimie du cerveau - 2 - Les neurotransmetteurs, messagers chimiques
- XXVI- Chimie du cerveau -3- Rôle des différents neurotransmetteurs
- XXXIV - Odorat, Odeurs et parfums
- XXXV- Bonnes et mauvaises odeurs
- XXXVI - Chimie et parfums
- XLIII - Chimie et couleur -1- De colore
- XLIV - Chimie et couleur -2- Couleurs végétales
- XLV - Chimie et couleur -3- : chimiothérapie et colorants
- XL- a - ADN, ARN, protéines
- XL- b - Chimie supramoléculaire
- XXXIX- Chimie et Synthetic Biology
- XLVI - Du génome au protéome
- 4 - Chimie et médecine
- VIII - Chimie et médecine : d'Hippocrate à Néron
- IX - Chimie et opium : voyages, voyages !
- XVII- Médecine et Chimie à Montpellier avant la Révolution
- XVIII - Le vitalisme de l'Ecole de Montpellier
- XXIX - Le médicament aujourd'hui
- XXVII - Autour de la sérotonine
- XXVIII - L'ocytocine
- XXX - Chimie, médecine, nanotechnologies
- L - Chimie et dopage -1- La chimie au service du dopage
- LI - Chimie et dopage - 2 - Les outils du chimiste contre le dopage
- XLIX - Image magnétique - 3 - de l'IRM au patient numérique
- 5 - La chimie moderne et ses hommes
- XXXI - Mendeleïev : un tableau de maître !
- XXXII - Mendeleïev : -2- Un chimiste russe au XIXème siècle
- XXXIII - Mendeleïev -3- Le fin mot de l'histoire
- XLI - Paul Sabatier, chimiste languedocien, prix Nobel 1912
- XLII - Victor Grignard, prix Nobel 1912
- XLVII - Image magnétique - 1 - Une histoire de spin
- XLVIII - Image magnétique - 2 - Mais que vient faire le chimiste dans cette galère ?
- 6 - Chimie : bonnes et mauvaises pratiques
- XXXVII- Du mauvais usage de la chimie
- XXXVIII- La chimie passe au vert
- Pour conclure
- Postface - Nylon by DuPont de Nemours
- Nylon... - Part A
- Nylon... - Part B
- Nylon... - Part C
- Nylon... - Part D
- La beauté des mathématiques
- Les sciences vers La Science
- La révolution numérique
- CRISPR-Cas9 : l'édition de gènes
- L'ombre de Frankenstein
- VOIR
- RECHERCHE, CONTACT
RESISTER ! Resist !
" Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques "
Jean JAURES (Juillet
1903)
‘Courage is seeking the truth and telling it; it is not submitting to the law of the triumphant lie that passes and not echoing the imbecilic applause and fanatical booing’.
Jean JAURES (July 1903)

Dans la présentation de ce site, que je commençais à construire dès 2008, j'avais notamment écrit ces deux phrases.
"J'ai compris qu'un scientifique, plus que tout autre pédagogue, doit être à l’écoute de son temps, suivre l’évolution de la pensée, être attentif aux mouvements d’idées et avoir des repères dans l’histoire de l’humanité."
"Donner à l'homme le moyen de s'affranchir de l'oppression, c'est l'éduquer, lui permettre d'activer sa propre réflexion, l'inciter au recul, à la distanciation."
JPL, 2008
In the presentation of this website, which I began building in 2008, I wrote these two sentences.
‘I realised that a scientist, more than any other educator, must be in tune with the times, follow the evolution of thought, be attentive to the movements of ideas and have reference points in the history of humanity’.
‘Giving people the means to free themselves from oppression means educating them, enabling them to activate their own thinking, encouraging them to stand back and distance themselves.’
JPL, 2008
Déjà s'annonçait ce nouvel âge de glace, ces replis vers le religieux, vers son clan, ce retour vers l'irrationnel, qui périodiquement dans l'histoire, agitent les sociétés et les hommes.
Il est vrai que l'extrême complexité du monde du vivant, que les dernières décennies avaient révélées, n'avait fait qu'aggraver le sentiment de fragilité de l'espèce humaine.
Déjà les multiples blessures narcissiques, que la science avait infligées à l'homme au cours des siècles (Copernic, Darwin, Freud...) avaient exacerbées cette l'angoisse existentielle propre à l'humain.
"« L’homme sait enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’univers d’où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n’est écrit nulle part. A lui de choisir entre le Royaume et les ténèbres. (…) Il sait maintenant que, comme un tzigane, il est en marge de l’univers où il doit vivre, un Univers sourd à sa musique, indifférent à ses espoirs comme à ses souffrances et à ses crimes »...,
écrivait déjà le prix Nobel de médecine, Jacques Monod, en 1970 ("Le Hasard et la Nécessité")
De tout temps, les scientifiques ont souffert de ces révoltes devant le néant qui nous semble promis, l'inquisition n'a pas touché que les juifs et les apostats.
La tentation était donc très forte pour eux de se terrer dans la paix relative de leurs laboratoires et de se tenir à l'écart du tumulte du monde, d'autant que leur intervention lors de la dernière guerre mondiale, à l'initiative d'Albert Einstein, avait traumatisé la communauté.
Ce n'était pas - et depuis longtemps- mon sentiment - le scientifique au contraire doit être au coeur des débats de son temps, s'engager - non dans des querelles politiciennes - mais pour défendre - ce qui est au fond sa raison d'être - la quête de la vérité.
L'arrivée au pouvoir de Donald Trump en 2016 aux USA a provoqué un électrochoc dans la communauté scientifique américaine, qui constitue - et de très loin - le potentiel principal de la recherche mondiale - et son avant-garde - dans pratiquement tous les domaines.
Pendant ce mandat cauchemardesque, où des instituts prestigieux ont été démantelés ou asphyxiés financièrement, nombre de chercheurs de haut rang ont commencé à réagir, notamment par le biais d'articles dans les deux revues mondiales de référence : Nature et Science (éditée par l'American Association for the Advancement of Science : AAAS).
Ce cauchemar n'est malheureusement pas terminé et la constitution du cabinet Trump II, annonce le pire :
- par la promotion à des postes clés des pires climatosceptiques,
- par la nomination à la tête de grandes institutions, comme le NHI (National Institutes of Health) de personnalités qualifiées au mieux d'excentriques ou de marginales par les observateurs polis et de dangereuses pour les autres.
La nomination d'une catcheuse à l'éducation et du fils de Robert Kennedy, que sa famille et bien d'autres, qualifient de "dérangé", dans le domaine de la santé et de l'industrie pharmaceutique sont d'autres signaux inquiétants pour la profession.
C'est pourquoi la riposte est nécessaire et nombreux sont maintenant les savants qui sont prêts à croiser le fer.
En témoigne ce long éditorial de Science, qui n'a pas pour habitude d'intervenir dans ce domaine.
L'auteur signale tout d'abord qu'une enquête, menée en octobre 2024 auprès de 9 593 adultes aux États-Unis, indique que 76 % des Américains ont désormais une grande confiance ou une assez grande confiance dans les scientifiques pour agir dans le meilleur intérêt du public.
Cela donne donc aux scientifiques une certaine autorité pour intervenir publiquement sur les sujets qui les concernent.
Cependant la propagande clivante de Trump a été en partie efficace puisque si la confiance est de 88% chez les Démocrates, elle stagne à 66% chez les Républicains.
Le débat est donc ouvert entre ceux qui pensent que les scientifiques doivent rester strictement "apolitiques" et ceux qui pensent "qu'une opposition totale à chaque attaque est nécessaire et appropriée".
Ceux-là sont majoritaires, si l'on en croit le courrier reçu par la revue.
Ainsi Katharine Hayhoe, une scientifique de l’atmosphère largement saluée pour sa capacité à communiquer avec des publics divers sur le changement climatique, pense qu’un choix entre plaidoyer et objectivité est une fausse dichotomie.
« Comme les philosophes l’ont longtemps soutenu », dit-elle « s’engager auprès de la société n’est pas une trahison de la science ; c’est un élément fondamental de son objectif, en particulier dans les crises complexes comme celles auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui. Prétendre que la science est dénuée de valeurs revient à ignorer la réalité dans laquelle nous vivons : chaque étape, de la recherche au dialogue sociétal, a un poids éthique.
La communauté scientifique a l’occasion d’apprendre du passé et de planifier l’avenir.
" les scientifiques ne sont pas seulement des cerveaux dans des bocaux ; nous sommes des êtres humains intégrés dans la société, apportant à la fois raison et principes à notre travail. » Les scientifiques doivent trouver de nouvelles approches pour projeter cette humanité de manière efficace." Katharine Hayhoe
C'est tout à fait ce que je pense et si - la science nous en préserve ! - les clones de Trump venaient à diriger ce pays, je veux croire que nos savants sauraient avoir la même réaction (même si l'affaire Raoult ne me rassure pas !).
Après tout, 92% des Français ont une bonne image de la science (hélas ce chiffre baisse significativement chez les jeunes, adeptes des réseaux sociaux).
Jean Pierre Lavergne, ancien professeur émérite, Université de Montpellier - Nov 2024
We were already witnessing the onset of a new Ice Age, a retreat into religion, into the clan, a return to the irrational, all of which periodically agitate societies and people throughout history.
It's true that the extreme complexity of the living world, revealed in recent decades, has only aggravated the human race's sense of fragility.
The multiple narcissistic wounds that science had inflicted on man over the centuries (Copernicus, Darwin, Freud...) had already exacerbated this existential anguish that is specific to humans.
‘’ Man finally knows that he is alone in the indifferent immensity of the universe from which he emerged by chance. Neither his destiny nor his duty is written anywhere. It is up to him to choose between the Kingdom and the darkness (...) He now knows that, like a gypsy, he is on the fringes of the universe in which he must live, a universe deaf to his music, indifferent to his hopes as well as to his suffering and crimes’...,
Jacques Monod, winner of the Nobel Prize for Medicine, wrote as long ago as 1970 (‘Chance and Necessity’).
Scientists have always suffered from these revolts in the face of the nothingness that seems promised to us, and the Inquisition did not only affect Jews and apostates.
The temptation was therefore very strong for them to hide away in the relative peace of their laboratories and to remain aloof from the tumult of the world, especially as their intervention in the last world war, on the initiative of Albert Einstein, had traumatised the community.
This was not - and has not been for a long time - my feeling. On the contrary, scientists should be at the heart of the debates of their time, getting involved - not in political quarrels - but to defend - what is basically their raison d'être - the quest for truth.
When Donald Trump came to power in the USA in 2016, it sent shockwaves through the American scientific community, which is by far the world's leading research potential - and its vanguard - in virtually every field.
During this nightmarish mandate, in which prestigious institutes were dismantled or financially asphyxiated, a number of top researchers began to react, notably by publishing articles in the world's two benchmark journals: Nature and Science (published by the American Association for the Advancement of Science: AAAS).
Unfortunately, this nightmare is not over, and the formation of the Trump II cabinet heralds the worst:
- by promoting the worst climate sceptics to key positions,
- by the appointment to head major institutions such as the NHI (National Institutes of Health) of personalities described at best as eccentric or marginal by polite observers and as dangerous by others.
The appointment of a wrestler to education and of Robert Kennedy's son, whom his family and many others describe as ‘deranged’, to the health and pharmaceutical industries are other worrying signals for the profession.
That's why we need to fight back, and many scientists are now ready to cross swords.
Witness this long editorial in Science, which does not usually intervene in this area.
The author begins by pointing out that a survey conducted in October 2024 among 9,593 adults in the United States shows that 76% of Americans now have a great deal or a fair amount of confidence in scientists to act in the best interests of the public.
This gives scientists a certain authority to speak out publicly on issues that concern them.
However, Trump's divisive propaganda has been partly effective: while 88% of Democrats trust scientists, 66% of Republicans do not.
The debate is therefore open between those who think that scientists should remain strictly ‘apolitical’ and those who think that ‘total opposition to every attack is necessary and appropriate’.
The latter are in the majority, if the letter received by the magazine is to be believed.
For example, Katharine Hayhoe, an atmospheric scientist widely acclaimed for her ability to communicate with diverse audiences about climate change, believes that a choice between advocacy and objectivity is a false dichotomy.
‘As philosophers have long argued’, she says, ’engaging with society is not a betrayal of science; it is a fundamental part of its purpose, particularly in complex crises such as those we are facing today. To claim that science is devoid of values is to ignore the reality in which we live: every stage, from research to societal dialogue, carries ethical weight.
The scientific community has the opportunity to learn from the past and plan for the future.
‘Scientists are not just brains in jars; we are human beings integrated into society, bringing both reason and principle to our work. Scientists need to find new approaches to project this humanity effectively.’ Katharine Hayhoe
That's exactly what I think, and if - science forbid! - Trump's clones were to lead this country, I want to believe that our scientists would have the same reaction (even if the Raoult affair doesn't reassure me!).
After all, 92% of French people have a good image of science (alas, this figure drops significantly among young people, who are adept at social networking).
Jean Pierre Lavergne, former Professor Emeritus, University of Montpellier - Nov 2024
‘Resist is then the most common, the most out-of-date watchword, which must be repeated over and over again, with the courage that goes with it every time.’
La démocratie américaine détricotée au profit d'une bande de "Pieds Nickelés" sans scrupules
Les scientifiques en appellent au peuple
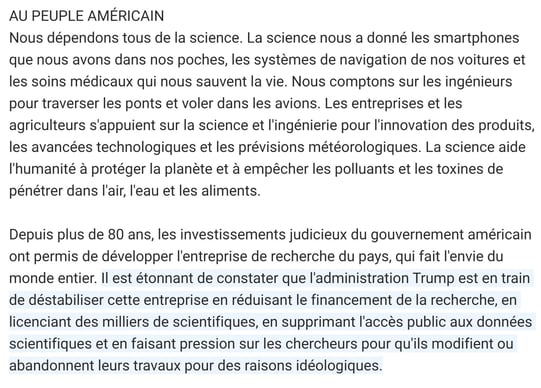
Ce qui se passe aux Etats-Unis est proprement stupéfiant.
C'est tout simplement une des démocraties les plus anciennes et les plus respectées dans le monde qui s'effondre en quelques semaines, sans provoquer de réactions massives de la population, ni des élus qui laissent à quelques juges courageux le soin de sauver ce qui peut l'être.
Ou plutôt de retarder l'avènement d'un état totalitaire ayant pour tout repère l'ARGENT.
Pour faire tomber quelques milliards de plus dans leurs escarcelles, Trump, Musk et leurs acolytes, liquident tout simplement les administrations centrales, le système de santé, l'organisation de la recherche et des universités, instaurent la censure et la chasse aux sorcières comme au plus beau temps de la révolution culturelle maoïste, prétendent restaurer le machisme le plus grossier et le racisme le plus ordinaire et surtout instaurer ce suprémacisme blanc que les idéologues qui les entourent prônent à longueur de colonnes.
Dans le même temps, ces deux triste sires abandonnent leurs alliés en rase campagne, rançonnent l'Ukraine, soutiennent Poutine contre l'Europe qu'ils détestent.
Jusqu'où pourront-ils aller sans que les citoyens ne réagissent ? Trump parle déjà d'un troisième mandat au mépris de la Constitution américaine qu'il viole allègrement tous les jours !
Certains dont je suis trouveront un petit réconfort en prenant connaissance de l'appel des plus grands scientifiques de ce grand pays au peuple américain.
C'est la première fois dans l'histoire qu'une levée en masse de cette communauté se produit face à un apprenti dictateur.
Elle est d'ailleurs relayée dans de nombreux pays, dont la France et son Académie.

Après le nez de Cléopâtre, l'oreille de Trump
La trajectoire d'une balle a changé la face du monde !
After Cleopatra's nose, Trump's ear
The trajectory of a bullet changed the face of the world!

« Qui voudra connaître à plein la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour. [...] Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé »
Blaise Pascal, Pensées
“Whoever wishes to know the full extent of man's vanity need only consider the causes and effects of love. [...] If Cleopatra's nose had been shorter, the whole face of the earth would have changed”.
Blaise Pascal, Pensées
Donald Trump est en train de bouleverser le monde et son propre pays.
Pas en bien !
On voit se mettre en place autour de lui un gang international d'oligarques, regardé en Europe avec gourmandise par les dirigeants italiens et hongrois et peut-être bientôt allemands et
français, - prêt à mettre la planète en coupe réglée.
Tout cela n'ira pas sans violence. Aux Etats-Unis, l'opposition politique est sonnée, mais dans la rue et sur les réseaux, l'opposition libérale appelle à la résistance et au combat contre ce nouvel assaut des Confédérés.
Les Unionistes n'ont pas dit leur dernier mot !
La guerre de Sécession n'est pas si loin !
Trump veut donner l'Europe à son ami Poutine. Mais si nombre de nos dirigeants se prêterait bien à un nouveau Munich et n'aurait aucun mal à désigner un nouveau Pétain (façon Zemmour par exemple), il n'en irait pas de même des populations qui ont encore en mémoire les horreurs de la dernière guerre.
Hitler et Staline ne sont pas si loin !
_______________________________
Imaginons qu'un coup de vent ait dévié de quelques millimétres la trajectoire de la balle, qui vienne alors percuter ce cerveau malade.
La face du monde n'en aurait-elle pas été changée ?
« Prédictibilité : le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? »
Ainsi est née, en mathématiques, la théorie du chaos, à savoir que, dans certains systèmes, une infime variation des conditions initiales conduit à des variations énormes quant au résultat final.
Pourquoi Trump 2.0 est beaucoup plus effrayant
Un tandem délirant et sans limite à la tête du plus puissant pays du monde

"Au cours de son premier mandat, le président Trump était entouré de tampons : des assistants, des secrétaires de cabinet et des généraux qui ont su à maintes reprises détourner et contenir ses pires impulsions.
Aujourd’hui, Trump n’est entouré que d’amplificateurs : des assistants, des secrétaires de cabinet, des sénateurs et des membres de la Chambre des représentants qui vivent dans la peur de sa colère ou d’être attaqués par des foules en ligne déchaînées par son homme de main, Elon Musk, s’ils sortent du rang..."
...
" Trump agit plus comme le Parrain que comme le président : « Vous avez là un joli petit territoire (le Groenland, le Panama, Gaza, la Jordanie, l’Égypte) – ce serait dommage qu’il lui arrive quelque chose de mal… "
LIRE L'ARTICLE COMPLET dans le New York Times
A méditer !

« Nous entrons au Reichstag pour nous munir des armes de la démocratie. « Si la démocratie est assez stupide pour nous donner des laissez-passer de chemin de fer et des salaires gratuits, c’est son problème. Cela ne nous concerne pas. N’importe quel moyen de provoquer la révolution nous convient. »
Joseph Goebbels
Why Do We Want to Join the Reichstag?
