Loi Duplomb
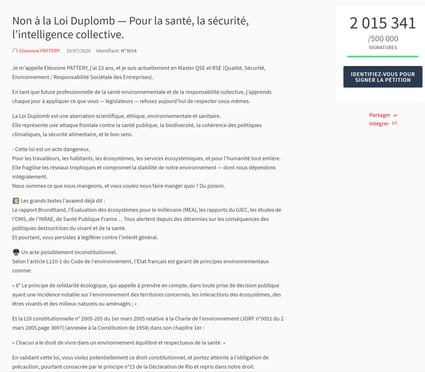
Deux millions de signatures ont été déposées sur le site de l'Assemblée Nationale, à la date du 28 juillet 2025, pour demander l'abrogation de la loi Duplomb rédigée par la FNSEA.
Une mobilisation sans précédent contre le tout polluer que veulent nous imposer les gros agriculteurs.
Ceux-là même qui envoient déjà leurs hommes de mains et leur fumier contre les militants écologistes, avec le soutien du .... ministre de la police !
Incroyable, scandaleux irresponsable : les scientifiques ont été tenus à l'écart de la préparation de la loi Duplomb, rédigée par la FNSEA !
« La loi Duplomb ignore les liens entre agriculture, santé, climat et biodiversité »
Coordinateur du chapitre sur l’alimentation dans le dernier rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité (IPBES) paru en décembre 2024
Pire, ils ont voté en ignorant deux avis de l'Anses qui proposait des alternatives aux néonicotinoïdes
Hervé Jactel est ingénieur agronome, entomologiste et directeur de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae)
Aujourd'hui certains députés (macronistes) proposent de saisir l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Ils ont donc voté les yeux fermés, malgré l’opposition des sociétés savantes médicales (cancérologie, pédiatrie, endocrinologie, hématologie, neurologie…) ou du conseil scientifique du CNRS, un texte qui prévoit de réautoriser une molécule à la toxicité avérée, appartenant à la famille des néonicotinoïdes, réclamée par les producteurs de betteraves sucrières qui affirment n’avoir aucune solution pour protéger leurs cultures des pucerons.
La question de la toxicité a déjà été tranchée à deux reprises par l'Anses :
Riche de 546 pages, le premier rapport de l’Anses sur l’évaluation comparative des risques et des bénéfices des néonicotinoïdes et des autres méthodes chimiques ou non chimiques a été remis en mai 2018.
Sur le cas particulier des pucerons de la betterave à sucre, le rapport identifiait déjà au moins une méthode alternative aussi efficace que la famille des néonicotinoïdes : associer deux insecticides autorisés, le lambda-cyhalothrine et le pyrimicarbe. « Ces insecticides de synthèse ne sont certes pas sans danger pour la biodiversité mais, à l’inverse des néonicotinoïdes qui sont appliqués de façon préventive et systématique, ces produits peuvent n’être appliqués qu’en cas de besoin en lutte curative, et de façon précise, ne ciblant que les champs effectivement menacés par une pullulation de pucerons, limitant d’autant leur impact sur les insectes pollinisateurs »
Hervé Jactel in Le Monde a présidé les deux groupes de travail de l’Anses sur les alternatives à l’usage des néonicotinoïdes.
Le deuxième avis de l’Anses a été rendu en mai 2021.
Exclusivement consacré à « l’efficacité des traitements disponibles pour lutter contre les pucerons de la betterave », identifie deux autres insecticides aux « impacts limités sur l’environnement et rapidement substituables aux néonicotinoïdes » : le flonicamide et le spirotétramate.
Toutes ces molécules sont beaucoup moins toxiques que les néonicotinoïdes
Enfin, deux études scientifiques publiées en 2023 et 2024 dans la revue Crop Protection sur la base d’une centaine d’essais menés en champ ont montré qu’ils étaient même beaucoup plus efficaces que l’acétamipride contre la jaunisse virale. Jusqu’à 87 % d’efficacité lorsque le traitement est associé à la plantation d’orge entre les rangs de betteraves contre seulement 55 % pour l’acétamipride.
Le Monde :
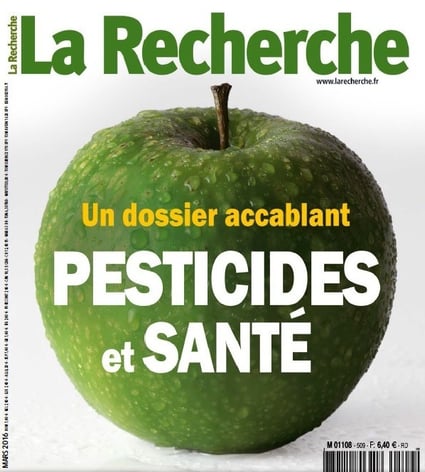
Ce qui se joue avec ce combat contre la loi Duplomb, va bien au-delà de l'utilisation d'un pesticide redoutable par des producteurs de noisettes et de betteraves !
L’agriculture productiviste, et l’élevage industriel qui lui est associé, sont déjà à l’origine de nombreuses dégradations environnementales, parfois de grande ampleur : l’effondrement de la population d’insectes et de pollinisateurs, plus généralement l’érosion de la biodiversité, la contamination des sols et de l’eau, une contribution importante au dérèglement climatique.
En juin 2021, le comité d’experts nommé par l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) a rendu ses conclusions sur les effets des pesticides sur la santé. Elles sont particulièrement inquiétantes.
Aux quatre pathologies pour lesquelles existait déjà une présomption forte de lien avec l’exposition aux pesticides sont venues s’ajouter six autres.
Les lobbies agricoles veulent en finir avec les régulations visant à contrôler l'agriculture intensive
Résistons !
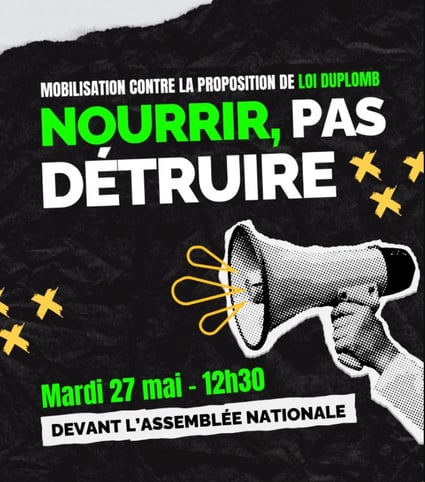
Ce qui se joue avec ce combat contre la loi Duplomb, va bien au-delà de l'utilisation d'un pesticide redoutable par des producteurs de noisettes et de betteraves !
En fait ce que veulent la FNSEA et les tenants d'une agriculture intensive :
- c'est se débarrasser de toutes les normes qui timidement ont été mises en place depuis une vingtaine d'années, pour pouvoir utiliser des intrants chimiques à tout va,
- créer, hors réglementation, des méga fermes d'élevages ou fermes-usines (1 million : c’est le nombre de volailles entassées dans une seule ferme-usine localisée dans l’Oise).
Dans un arrêté publié en avril dernier, la préfecture valide le projet d'extension d'une ferme répartie sur trois sites à Éragny-sur-Epte, Flavancourt et Sérifontaine de 948.000 poules pondeuses à 1,2 millions.
Aujourd’hui, 60% des animaux sont concentrés dans 3% des fermes d’élevage en France,
- accéder sans limites à la ressource en eau.
Sur tous ces points la loi Duplomb leur donne un blanc-seing.
L’agriculture productiviste, et l’élevage industriel qui lui est associé, sont déjà à l’origine de nombreuses dégradations environnementales, parfois de grande ampleur : l’effondrement de la population d’insectes et de pollinisateurs, plus généralement l’érosion de la biodiversité, la contamination des sols et de l’eau, une contribution importante au dérèglement climatique.
La plupart des solutions proposées pour réduire les effets nocifs de l’agriculture remettent en cause le productivisme : relocalisation des systèmes de production agricole, agroécologie et agroforesterie, permaculture, agriculture biologique...
Les effets pervers de l'agriculture intensive
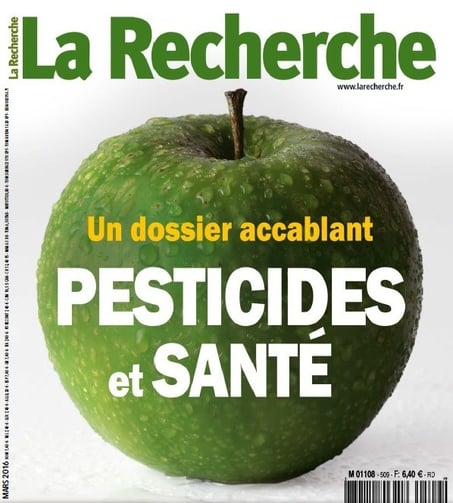
Ils sont multiples... Je vais me contenter d'en évoquer trois.
1° La libération massive de phosphore et d'azote, principaux composants des engrais chimiques utilisés dans l’agriculture intensive pour améliorer la croissance des plantes, dégrade la qualité des sols et compromet les capacités de production. Elle mène à des asphyxies de larges zones marines.
En s’infiltrant dans les nappes phréatiques, les phosphates et les nitrates atteignent les cours d’eau, polluent l’eau potable et dégradent les eaux douces et marines jusqu’à les asphyxier. Les algues, trop nourries, prolifèrent, ce qui diminue fortement la disponibilité en oxygène pour les autres êtres vivants.
Ce processus, appelé « eutrophisation », entraîne avec lui l’érosion de la biodiversité et la multiplication d’espèces nuisibles.
Cette transgression alarme les scientifiques qui craignent une extinction massive d’espèces marines causée par un manque d’oxygène dans les océans et qui affecterait l’ensemble de la chaîne alimentaire. Aujourd’hui, on estime que la limite planétaire du cycle de l’azote et du phosphore a déjà été dépassée.
Je veux rappeler que les océans absorbent 30% du CO2 de la planète et produisent entre 50% et 75% de l'oxygène que nous respirons, selon les sources et les zones géographiques
2° La production d’aliments participe au changement climatique à différentes étapes : agriculture, stockage, transformation, transport. Elle est responsable d’environ 30 % des émissions globales de gaz à effet de serre (Source rapport du Giec 2019).
A l’échelle mondiale, l’agriculture rejette 40 % du gaz méthane total émis, via la digestion des ruminants et aussi, la culture du riz dans les rizières. Les épandages de déjections d’élevage dans le sol, et les engrais de synthèse azotés, lessivés et volatilisés émettent 80 % du protoxyde d’azote.
Les élevages industriels de porcs et de poulets sont moins émetteurs de méthane, mais ils consomment des végétaux, en concurrence directe avec l’alimentation humaine, et posent d’autres problèmes environnementaux notamment des pollutions locales de l’eau.
3° L'utilisation massive d'intrants par ce type d'agriculture (engrais, pesticides, herbicides, insecticides...) pose une problème majeur pour la santé publique.
Les analyses de plus de 5 000 aliments, réalisées par les autorités françaises en 2020 et 2021, révèlaient que la nourriture est, dans notre pays, contaminée par au moins 183 types de résidus de pesticides.
La réglementation complète pour l'usage des intrants, émanant du ministère de l'agriculture, peut-être téléchargée ICI.
Le problème est que ces molécules, loin d'être biodégradables comme l'affirme certaines firmes, peuvent rester longtemps dans notre environnement.
Ainsi le lindane, un insecticide toxique, est toujours dans l'air et dans le sol français. C'est ce que révèle une étude publiée en 2020 par Santé Publique France (SPF). Ce pesticide est pourtant interdit en France depuis 1998. Et sa toxicité était déjà dénoncée dans les années 1980 !
Aux quatre pathologies pour lesquelles existait déjà une présomption forte de lien avec l’exposition aux pesticides sont venues s’ajouter six autres. Maladie de Parkinson, lymphome non hodgkinien, myélome multiple (un autre cancer du sang) et cancer de la prostate sont à présent rejoints par les troubles cognitifs, la BPCO (une pneumopathie chronique), la bronchite chronique, mais aussi, chez les enfants des femmes exposées durant la grossesse, les troubles neurodéveloppementaux, les leucémies et les cancers du système nerveux central.
De plus, "une présomption « de niveau moyen » concernant un effet des pesticides (ou au moins de certains d'entre eux) est également relevée pour neuf grands autres types de pathologies : les troubles anxiodépressifs, la maladie d’Alzheimer, l’asthme et les sifflements respiratoires, les pathologies thyroïdiennes, la leucémie chez l’adulte et enfin les cancers du sein, de la vessie, du rein, des tissus mous et des viscères.
Les liens les plus clairement démontrés l’ont été, la plupart du temps, chez des agriculteurs et autres professionnels manipulant des pesticides dans leur travail, puisqu’ils sont à la fois les plus exposés et les plus étudiés. Viennent ensuite les femmes contaminées durant la grossesse – car le fœtus est particulièrement sensible aux effets des toxiques – ainsi que les adultes riverains des champs ou utilisant des pesticides à domicile.
Cette course démente à l'armement chimique contre les nuisibles menace de devenir incontrôlable car les espèces nuisibles développent une résistance aux pesticides par la sélection naturelle : les spécimens les plus résistants survivent et transmettent leurs traits génétiques à leur descendance.
On estime que depuis le début de l'étude du phénomène plus de 1000 espèces de bioagresseurs ont développé une résistance à un pesticide.
Voilà pourquoi, au delà du symbole qu'est la pétition contre la loi Duplomb, il faut résister à la tentation productiviste qui met en grand danger notre planète et la santé de nos enfants et des générations futures.
Aujourd'hui, c'est 1 enfant sur 440 qui développe un cancer avant l'âge de 15 ans en France et le nombre de cancers infantiles augmente de 1 à 2% par an en Europe, depuis 30 ans. Aujourd'hui, les cancers pédiatriques représentent toujours la première cause de mortalité par maladie chez les moins de 15 ans.
On pourrait aussi se demander pourquoi tant de cancers du sein avant 30 ans, de la prostate avant 50 ans, pourquoi le nombre de cancers du pancréas explose...
Pourquoi toutes ces maladies neurodégératives chez des sujets de plus en plus jeunes ?
...
Notre environnement n'y est pas pour rien.
